La Lettre de Simone #1 (nouvelle formule)
« Cee avait consenti à cette étiquette et se croyait sans valeur »
T. Morrison, Home
« Pour tout dire, nous ne voyons pas les choses mêmes ; nous nous bornons, le plus souvent, à lire des étiquettes collées sur elles. »
H. Bergson, Le rire
« Dénommer quelque chose est analogue au fait d’attacher à une chose une étiquette portant son nom ».
L. Wittgentstein, Recherches philosophiques
Des mots plus ou moins discrets nous habitent jusqu’à hanter nos choix et nos actes les plus ordinaires. Sans toujours les voir, nous les relisons, réécoutons, réécrivons, redisons, remodelons, redoutons, recherchons, relions, renions, replaçons, repleurons. Ils font jouer en nous ces ritournelles que nous plaquons sur le monde, sur les autres et sur nous-mêmes, comme si les mots étaient ce que nous désignons à travers eux.
Aussi pesants puissent-ils être parfois, nous les transportons partout, prolongeant le consentement spontané une fois accordé, par excès d’ignorance. Il faut bien obéir aux mots et les répéter, pour ensuite, peut-être, se rendre capables de les questionner. Pour le meilleur et pour le pire, nous leur sommes attachés comme à nos racines : ils préfigurent notre manière d’exister et de percevoir. Au lieu d’avoir à sonder les reliefs fins et changeants des êtres dont nous parlons, nous n’avons plus qu’à manipuler les mots arbitrairement « collés » sur eux. Nous formulons et résolvons nos questions avec des mots docilement lus et entendus.
Nommer
Qu’est-ce que c’est ? Qui est-ce ? Qui suis-je ? X, Y., Z. La curiosité première qui appelle à sentir ce que le réel a de vivant et de polymorphe laisse subrepticement place à l’art d’articuler des étiquettes. « C’est un arbre », répondrons-nous rapidement à l’enfant pointant son doigt vers l’inconnu. Nous lui apprenons par là que dire ce qu’est une chose, c’est nommer la catégorie dans laquelle on la classe, répéter l’étiquette qui lui est conventionnellement attachée. Selon le degré de précision de nos connaissances du sujet, la catégorie nommée sera plus ou moins resserrée : arbre, érable, érable jaspé de rouge par exemple. C’est en ce sens que Wittgenstein, dans la citation mise en exergue, compare les noms communs à des étiquettes attachées aux choses : dénommer ou désigner consiste à inscrire de manière figurée des signes sur les choses1.
C’est extraordinairement utile. Le langage rend les choses bien plus facilement manipulables, individuellement et collectivement. Mais, comme y insiste Bergson, cette utilité du langage a aussi pour effet de diminuer notre capacité d’accéder au réel lui-même, tant pour ce qui concerne les choses extérieures à nous que pour ce qui relève de notre propre vie psychique. Dans notre effort pour entrer en contact avec les choses et avec nos états mentaux, nous nous heurtons à cette surface opaque de catégories, d’étiquettes qui fige notre regard.
Classer et masquer
Les étiquettes sont ces choses plus ou moins discrètes, fixées sur des objets, portant des inscriptions qui en indiquent des caractéristiques (composants, taille, prix, conditions optimales d’entretien ou de conservation, marque, nom du propriétaire, etc.). Ni drôles, ni poétiques, les étiquettes s’en tiennent à une fonction informationnelle minimale. Plus précisément, elles apportent l’information que la seule observation de l’objet ne fournit pas. Par exemple, l’étiquette d’un pull ne dit pas qu’il est bleu et celle d’un camembert ne dit pas qu’il est rond. De même, le mot « arbre » renvoie à une catégorie du genre végétal et n’indique pas ce que vous pourrez sentir de lui par vos cinq sens. Liées aux objets, les étiquettes sont indifférentes aux informations perceptibles par l’utilisateur.
Étrangement, il en va autrement lorsqu’il est question des personnes, de leur couleur de peau ou de leurs formes par exemple, pourtant observables. C’est que les petites étiquettes sont aussi de grands rideaux occultants, sur lesquels sont projetées des images sociales, dont la fonction n’est pas informative mais normative, distinctive, classificatoire. Or, bien souvent, nous leur accordons tellement de crédit que nous ne cherchons même plus à user de notre propre faculté de perception et d’analyse : nous nous passons les mots les uns aux autres, relayant ainsi les préjugés qu’ils contiennent. « Chaque mot est un préjugé », résumait Nietzsche2.
Ne pas consentir aux étiquettes
On a pu éprouver la violence de ces étiquettes dont on reste toujours trop longtemps les détenus. Désobéir aux qualificatifs qui nous ont été un jour attribués constitue un chemin de délivrance bien inconfortable. Dans un magnifique chapitre de Home, Toni Morrison dessine la métamorphose de Cee, la sœur du personnage principal, Franck Money. La compagnie d’un groupe de femmes combattives et indépendantes qui la soignent sans relâche en conversant et cousant conduit Cee à se détacher pour la première fois de l’étiquette qui lui colle à la peau et à l’âme depuis la naissance : « l’enfant du ruisseau »3. En les regardant et en recevant leur attention, la jeune femme comprend qu’elle a en elle la puissance et le devoir de penser et de se respecter, c’est-à-dire de contredire l’étiquette jusqu’alors acceptée. De l’observation silencieuse de ses nouvelles tutrices surgit en elle le pouvoir de contester les mots qui la tenaient en otage.
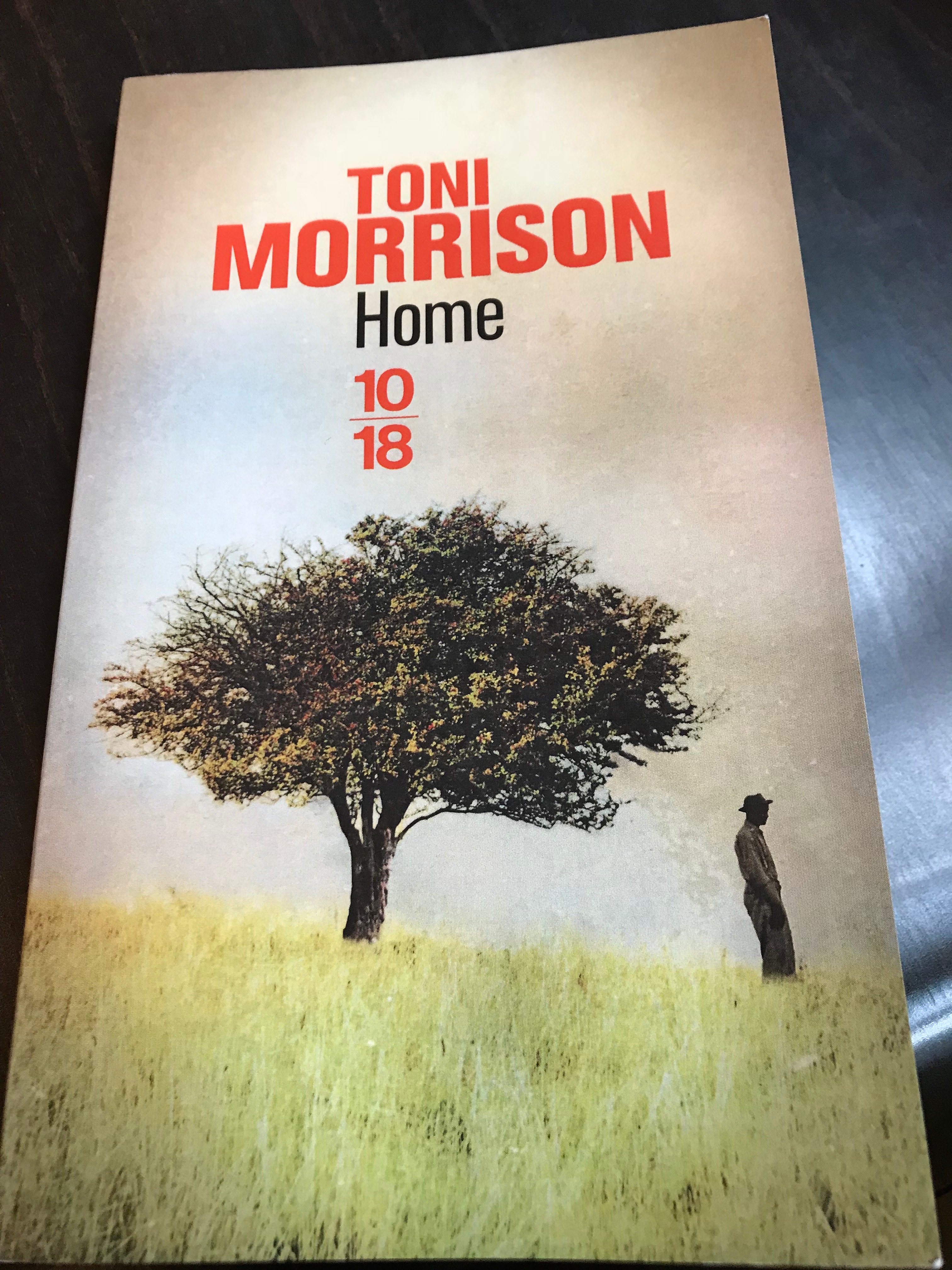
S’élever contre les barbelés des qualificatifs reçus inaugure la puissance de résilience. Mais encore faut-il comprendre que, pour y parvenir, il faut aussi renoncer à contenir les autres êtres dans les clôtures de nos propres mots. Qui donc peut assurer n’avoir jamais cédé à la facilité de l’étiquetage par les mots, n’avoir jamais répercuté ceux-là mêmes qui l’ont pourtant blessé·e ?
C’est que le refus d’étiquettes engendre pas mal d’inconfort : il suppose de renoncer aux raccourcis familiers qui ont structuré notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. Tel est l’inconfort du souci de vérité, et conjointement de l’émancipation : il faut accepter qu’on ait pu se tromper, que tout soit différent des catégories de classement qu’on a retenues, ressassées. Alors les mots eux-mêmes se trouvent délivrés de notre mépris des nuances et peuvent devenir matière à inventivité, à poésie, à humour, à liberté. C’est sans doute ce qui rend la pensée si périlleuse et si nécessaire : habiter ce que les mots ont de vivant pour ne pas se laisser hanter par eux.
Pour approfondir en explorant sur ce site, voici deux liens :
- - ce court podcast sur le langage vu par Bergson
- - (re)lire une réflexion sur le bafouillement, appréhendé comme l’acte de chercher des mots justes
1 § 15. Peut-être la façon la plus directe d’appliquer le mot « désigner » est-elle d’inscrire le signe sur l’objet désigné. Suppose que les outils dont A se sert pour réaliser sa construction soient marqués de certains signes. Dès que A montre le signe en question à son aide, celui-ci lui apporte l’outil marqué de ce signe. C’est de cette manière, et de manières plus ou moins analogues, qu’un nom désigne une chose et qu’un nom est donné à une chose. – Quand nous philosophons, il se révèlera souvent utile de nous dire que dénommer quelque chose est analogue au fait d’attacher à une chose une étiquette portant son nom.
2 Humain trop humain, tome II, § 55.
3 « Désignée très tôt par Lenore – la seule dont l’opinion importait à ses parents – comme « enfant du ruisseau » rebutante et à peine tolérée, Cee avait consenti à cette étiquette et se croyait sans valeur, exactement comme l’avait expliqué Mlle Ethel. (…) Seul Franck l’estimait. Si son dévouement la protégeait, il ne la fortifiait pas. (…) Cela ne tenait donc qu’à elle. Dans ce monde, parmi ces gens, elle voulait être l’individu qui n’aurait plus jamais besoin d’être secouru. (…)Avait-elle un cerveau, oui ou non ? Regretter n’arrangerait rien, s’en vouloir non plus, mais réfléchir peut-être. Si elle ne se respectait pas elle-même, pourquoi quelqu’un d’autre devrait-il le faire ? »
—
Publié le 9 novembre 2018
—